J'ai rassemblé ici deux discours (ainsi que deux citations ci-dessous) qui permettent de comprendre la position européiste et fédéraliste de Victor Hugo. Si je ne cherche pas ici à commenter ces discours, simplement à le mettre à disposition de mes lecteurs comme une source, je me suis cependant permis de mettre certains passages en gras lorsqu'ils me paraissaient particulièrement pertinents dans le contexte de ce blog.
VICTOR HUGO :
Discours aux Congrès de la Paix de 1849 et 1869
Suivis d’extraits du discours « Pour
la Guerre dans le présent et pour la Paix dans l’avenir » du 1er
mars 1871
« Et de l’union des libertés
dans la fraternité des peuples naîtra la sympathie des âmes, germe de cet
immense avenir où commencera pour le genre humain la vie universelle et que
l’on appellera la Paix de l’Europe »
« Il y a aujourd’hui une nationalité
européenne, comme il y avait, au temps d’Eschyle, de Sophocle et d’Euripide,
une nationalité grecque. »
Victor Hugo
Congrès de la Paix de 1849
I
DISCOURS D’OUVERTURE
Paris, 21 août 1849.
M. Victor Hugo est élu président. M. Cobden est élu vice-président.
M. Victor Hugo se lève et dit :
Messieurs, beaucoup
d’entre vous viennent des points du globe les plus éloignés, le cœur plein
d’une pensée religieuse et sainte. Vous comptez dans vos rangs des publicistes,
des philosophes, des ministres des cultes chrétiens, des écrivains éminents, plusieurs
de ces hommes considérables, de ces hommes publics et populaires qui sont les
lumières de leur nation. Vous avez voulu dater de Paris les déclarations de
cette réunion d’esprits convaincus et graves, qui ne veulent pas seulement le
bien d’un peuple, mais qui veulent le bien de tous les peuples. (Applaudissements.)
Vous venez ajouter aux principes qui dirigent aujourd’hui les hommes d’état,
les gouvernants, les législateurs, un principe supérieur. Vous venez tourner en
quelque sorte le dernier et le plus auguste feuillet de l’évangile, celui qui
impose la paix aux enfants du même Dieu, et, dans cette ville qui n’a encore
décrété que la fraternité des citoyens, vous venez proclamer la fraternité des
hommes.
Soyez les bienvenus! (Long
mouvement.)
En présence d’une
telle pensée et d’un tel acte, il ne peut y avoir place pour un remerciement
personnel. Permettez-moi donc, dans les premières paroles que je prononce
devant vous, d’élever mes regards plus haut que moi-même, et d’oublier, en
quelque sorte, le grand honneur que vous tenez de me conférer, pour ne songer
qu’à la grande chose que vous voulez faire.
Messieurs, cette
pensée religieuse, la paix universelle, toutes les nations liées entre elles
d’un lien commun, l’évangile pour loi suprême, la médiation substituée à la
guerre, cette pensée religieuse est-elle une pensée pratique ? Cette idée
sainte est-elle une idée réalisable ? Beaucoup d’esprits positifs, comme
on parle aujourd’hui, beaucoup d’hommes politiques vieillis, comme on dit, dans
le maniement des affaires, répondent : Non. Moi, je réponds avec vous, je
réponds sans hésiter, je réponds : Oui ! (applaudissements) et
je vais essayer de le prouver tout à l’heure.
Je vais plus
loin ; je ne dis pas seulement : C’est un but réalisable, je
dis : C’est un but inévitable ; on peut en retarder ou en hâter
l’avènement, voilà tout.
La loi du monde n’est
pas et ne peut pas être distincte de la loi de Dieu. Or, la loi de Dieu, ce
n’est pas la guerre, c’est la paix. (Applaudissements.) Les hommes ont
commencé par la lutte, comme la création par le chaos. (Bravo !
bravo !) D’où viennent-ils ? De la guerre ; cela est
évident. Mais où vont-ils ? À la paix ; cela n’est pas moins évident.
Quand vous affirmez
ces hautes vérités, il est tout simple que votre affirmation rencontre la
négation ; il est tout simple que votre foi rencontre l’incrédulité ;
il est tout simple que, dans cette heure de nos troubles et de nos
déchirements, l’idée de la paix universelle surprenne et choque presque comme
l’apparition de l’impossible et de l’idéal ; il est tout simple que l’on
crie à l’utopie ; et, quant à moi, humble et obscur ouvrier dans cette
grande œuvre du dix-neuvième siècle, j’accepte cette résistance des esprits
sans qu’elle m’étonne ni me décourage. Est-il possible que vous ne fassiez pas
détourner les têtes et fermer les yeux dans une sorte d’éblouissement, quand,
au milieu des ténèbres qui pèsent encore sur nous, vous ouvrez brusquement la
porte rayonnante de l’avenir ? (Applaudissements)
Messieurs, si quelqu’un, il y a quatre siècles, à l’époque où la guerre
existait de commune à commune, de ville à ville, de province à province, si
quelqu’un eût dit à la Lorraine, à la Picardie, à la Normandie, à la Bretagne,
à l’Auvergne, à la Provence, au Dauphiné, à la Bourgogne : un jour viendra
où vous ne vous ferez plus la guerre, un jour viendra où vous ne lèverez plus
d’hommes d’armes les uns contre les autres, un jour viendra où l’on ne dira
plus : — Les normands ont attaqué les picards, les lorrains ont repoussé
les bourguignons. Vous aurez bien encore des différends à régler, des intérêts
à débattre, des contestations à résoudre, mais savez vous ce que vous mettrez à
la place des hommes d’armes ? Savez-vous ce que vous mettrez à la place
des gens de pied et de cheval, des canons, des fauconneaux, des lances, des
piques, des épées ? Vous mettrez une petite boîte de sapin que vous
appellerez l’urne du scrutin, et de cette boîte il sortira, quoi ? Une
assemblée ! Une assemblée en laquelle vous vous sentirez tous vivre, une
assemblée qui sera comme votre âme à tous, un concile souverain et populaire
qui décidera, qui jugera, qui résoudra tout en loi, qui fera tomber le glaive
de toutes les mains et surgir la justice dans tous les cœurs, qui dira à
chacun : Là finit ton droit, ici commence ton devoir. Bas les armes !
vivez en paix ! (Applaudissements.) Et ce jour-là, vous vous
sentirez une pensée commune, des intérêts communs, une destinée commune ;
vous vous embrasserez, vous vous reconnaîtrez fils du même sang et de la même
race ; ce jour-là, vous ne serez plus des peuplades ennemies, vous serez
un peuple ; vous ne serez plus la Bourgogne, la Normandie, la Bretagne, la
Provence, vous serez la France. Vous ne vous appellerez plus la guerre, vous
vous appellerez la civilisation.
Si quelqu’un eût dit cela à cette époque, messieurs, tous les hommes
positifs, tous les gens sérieux, tous les grands politiques d’alors se fussent
écriés : — Oh ! Le songeur ! Oh ! Le rêve-creux !
Comme cet homme connaît peu l’humanité ! Que voilà une étrange folie et
une absurde chimère ! — Messieurs, le temps a marché, et cette chimère,
c’est la réalité. (Mouvement.)
Et, j’insiste sur
ceci, l’homme qui eût fait cette prophétie sublime eût été déclaré fou par les
sages, pour avoir entrevu les desseins de Dieu ! (Nouveau mouvement.)
Eh bien ! vous dites aujourd’hui, et je suis de ceux qui disent avec
vous, tous, nous qui sommes ici, nous disons à la France, à l’Angleterre, à la
Prusse, à l’Autriche, à l’Espagne, à l’Italie, à la Russie, nous leur
disons :
Un jour viendra où les armes vous tomberont des mains, à vous aussi !
Un jour viendra où la guerre paraîtra aussi absurde et sera aussi impossible
entre Paris et Londres, entre Pétersbourg et Berlin, entre Vienne et Turin,
qu’elle serait impossible et qu’elle paraîtrait absurde aujourd’hui entre Rouen
et Amiens, entre Boston et Philadelphie. Un jour viendra où vous France, vous
Russie, vous Italie, vous Angleterre, vous Allemagne, vous toutes, nations du
continent, sans perdre vos qualités distinctes et votre glorieuse
individualité, vous vous fondrez étroitement dans une unité supérieure, et vous
constituerez la fraternité européenne, absolument comme la Normandie, la
Bretagne, la Bourgogne, la Lorraine, l’Alsace, toutes nos provinces, se sont
fondues dans la France. Un jour viendra où il n’y aura plus d’autres champs de
bataille que les marchés s’ouvrant au commerce et les esprits s’ouvrant aux
idées. Un jour viendra où les boulets et les bombes seront remplacés par les
votes, par le suffrage universel des peuples, par le vénérable arbitrage d’un
grand sénat souverain qui sera à l’Europe ce que le parlement est à
l’Angleterre, ce que la diète est à l’Allemagne, ce que l’assemblée législative
est à la France ! (Applaudissements.) Un jour viendra où l’on
montrera un canon dans les musées comme on y montre aujourd’hui un instrument
de torture, en s’étonnant que cela ait pu être ! (Rires et bravos.)
Un jour viendra où l’on verra ces deux groupes immenses, les États-Unis
d’Amérique, les États-Unis d’Europe (applaudissements), placés en face
l’un de l’autre, se tendant la main par-dessus les mers, échangeant leurs
produits, leur commerce, leur industrie, leurs arts, leurs génies, défrichant
le globe, colonisant les déserts, améliorant la création sous le regard du
créateur, et combinant ensemble, pour en tirer le bien-être de tous, ces deux
forces infinies la fraternité des hommes et la puissance de Dieu ! (Longs applaudissements.)
Et ce jour-là, il ne faudra pas quatre cents ans pour l’amener, car nous
vivons dans un temps rapide, nous vivons dans le courant d’événements et
d’idées le plus impétueux qui ait encore entraîné les peuples, et, à l’époque
où nous sommes, une année fait parfois l’ouvrage d’un siècle.
Et français, anglais,
belges, allemands, russes, slaves, européens, américains, qu’avons-nous à faire
pour arriver le plus tôt possible à ce grand jour ? Nous aimer. (Immenses
applaudissements.)
Nous aimer ! Dans
cette œuvre immense de la pacification, c’est la meilleure manière d’aider
Dieu !
Car Dieu le veut, ce but
sublime ! Et voyez, pour y atteindre, ce qu’il fait de toutes parts !
Voyez que de découvertes il fait sortir du génie humain, qui toutes vont à ce
but, la paix ! Que de progrès, que de simplifications ! Comme la
nature se laisse de plus en plus dompter par l’homme ! Comme la matière
devient de plus en plus l’esclave de l’intelligence et la servante de la
civilisation ! Comme les causes de guerre s’évanouissent avec les causes
de souffrance ! Comme les peuples lointains se touchent ! Comme les
distances se rapprochent ! Et le rapprochement, c’est le commencement de
la fraternité.
Grâce aux chemins de
fer, l’Europe bientôt ne sera pas plus grande que ne l’était la France au moyen
âge ! Grâce aux navires à vapeur, on traverse aujourd’hui l’Océan plus
aisément qu’on ne traversait autrefois la Méditerranée ! Avant peu,
l’homme parcourra la terre comme les dieux d’Homère parcouraient le ciel, en
trois pas. Encore quelques années, et le fil électrique de la concorde
entourera le globe et étreindra le monde. (Applaudissements.)
Ici, messieurs, quand
j’approfondis ce vaste ensemble, ce vaste concours d’efforts et d’événements,
tous marqués du doigt de Dieu ; quand je songe à ce but magnifique, le
bien-être des hommes, la paix ; quand je considère ce que la providence
fait pour et ce que la politique fait contre, une réflexion douloureuse s’offre
à mon esprit.
Il résulte des
statistiques et des budgets comparés que les nations européennes dépensent tous
les ans, pour l’entretien de leurs armées, une somme qui n’est pas moindre de
deux milliards, et qui, si l’on y ajoute l’entretien du matériel des
établissements de guerre, s’élève à trois milliards. Ajoutez-y encore le
produit perdu des journées de travail de plus de deux millions d’hommes, les
plus sains, les plus vigoureux, les plus jeunes, l’élite des populations,
produit que vous ne pouvez pas évaluer à moins d’un milliard, et vous arrivez à
ceci que les armées permanentes coûtent annuellement à l’Europe quatre
milliards. Messieurs, la paix vient de durer trente-deux ans, et en trente-deux
ans la somme monstrueuse de cent vingt-huit milliards a été dépensée pendant la
paix pour la guerre! (Sensation.) Supposez que les peuples d’Europe, au
lieu de se défier les uns des autres, de se jalouser, de se haïr, se fussent aimés ;
supposez qu’ils se fussent dit qu’avant même d’être français, ou anglais, ou
allemands, on est homme, et que, si les nations sont des patries, l’humanité
est une famille. Et maintenant, cette somme de cent vingt-huit milliards, si
follement et si vainement dépensée par la défiance, faites-la dépenser par la
confiance ! Ces cent vingt-huit milliards donnés à la haine, donnez-les à
l’harmonie ! Ces cent vingt-huit milliards donnés à la guerre, donnez-les
à la paix ! (applaudissements) donnez-les au travail, à
l’intelligence, à l’industrie, au commerce, à la navigation, à l’agriculture,
aux sciences, aux arts, et représentez-vous le résultat. Si, depuis trente-deux
ans, cette gigantesque somme de cent vingt-huit milliards avait été dépensée de
cette façon, l’Amérique, de son côté, aidant l’Europe, savez-vous ce qui serait
arrivé ? La face du monde serait changée ! les isthmes seraient
coupés, les fleuves creusés, les montagnes percées, les chemins de fer
couvriraient les deux continents, la marine marchande du globe aurait centuplé,
et il n’y aurait plus nulle part ni landes ni jachères, ni marais ; on
bâtirait des villes là où il n’y a encore que des solitudes ; on
creuserait des ports là où il n’y a encore que des écueils ; l’Asie serait
rendue à la civilisation, l’Afrique serait rendue à l’homme ; la richesse
jaillirait de toutes parts de toutes les veines du globe sous le travail de
tous les hommes, et la misère s’évanouirait ! Et savez-vous ce qui
s’évanouirait avec la misère ? Les révolutions. (Bravos prolongés.)
Oui, la face du monde serait changée ! Au lieu de se déchirer entre soi,
on se répandrait pacifiquement sur l’univers ! Au lieu de faire des
révolutions, on ferait des colonies ! Au lieu d’apporter la barbarie à la
civilisation, on apporterait la civilisation à la barbarie ! (Nouveaux
applaudissements)
Voyez, messieurs, dans
quel aveuglement la préoccupation de la guerre jette les nations et les
gouvernants ; si les cent vingt-huit milliards qui ont été donnés par
l’Europe depuis trente-deux ans à la guerre qui n’existait pas avaient été
donnés à la paix qui existait, disons-le, et disons-le bien haut, on n’aurait
rien vu en Europe de ce qu’on y voit en ce moment ; le continent, au lieu
d’être un champ de bataille, serait un atelier ; et, au lieu de ce
spectacle douloureux et terrible, le Piémont abattu, Rome, la ville éternelle,
livrée aux oscillations misérables de la politique humaine, la Hongrie et
Venise qui se débattent héroïquement, la France inquiète, appauvrie et sombre,
la misère, le deuil, la guerre civile, l’obscurité sur l’avenir ; au lieu
de ce spectacle sinistre, nous aurions sous les yeux l’espérance, la joie, la
bienveillance, l’effort de tous vers le bien-être commun, et nous verrions
partout se dégager de la civilisation en travail le majestueux rayonnement de
la concorde universelle. (Bravo ! bravo. — Applaudissements.)
Chose digne de
méditation ! ce sont nos précautions contre la guerre qui ont amené les
révolutions. On a tout fait, on a tout dépensé contre le péril imaginaire. On a
aggravé ainsi la misère, qui était le péril réel. On s’est fortifié contre un
danger chimérique, on a tourné ses regards du côté où n’était pas le point
noir, on a vu les guerres qui ne venaient pas, et l’on n’a pas vu les
révolutions qui arrivaient. (Longs applaudissements.)
Messieurs, ne
désespérons pas pourtant. Au contraire, espérons plus que jamais ! Ne nous
laissons pas effrayer par des commotions momentanées, secousses nécessaires
peut-être des grands enfantements. Ne soyons pas injustes pour les temps où
nous vivons, ne voyons pas notre époque autrement qu’elle n’est. C’est une
prodigieuse et admirable époque après tout, et le dix-neuvième siècle sera,
disons-le hautement, la plus grande page de l’histoire. Comme je vous le
rappelais tout à l’heure, tous les progrès s’y révèlent et s’y manifestent à la
fois, les uns amenant les autres ; chute des animosités internationales,
effacement des frontières sur la carte et des préjugés dans les cœurs, tendance
à l’unité, adoucissement des mœurs, élévation du niveau de l’enseignement et
abaissement du niveau des pénalités, domination des langues les plus
littéraires, c’est-à-dire les plus humaines ; tout se meut en même temps,
économie politique, science, industrie, philosophie, législation, et converge au
même but, la création du bien-être et de la bienveillance, c’est-à dire, et
c’est là pour ma part le but auquel je tendrai toujours, extinction de la
misère au dedans, extinction de la guerre au dehors. (Applaudissements.)
Oui, je le dis en
terminant, l’ère des révolutions se ferme, l’ère des améliorations commence. Le
perfectionnement des peuples quitte la forme violente pour prendre la forme
paisible. Le temps est venu où la providence va substituer à l’action
désordonnée des agitateurs l’action religieuse et calme des pacificateurs. (Oui !
oui !)
Désormais, le but de
la politique grande, de la politique vraie, le voici : faire reconnaître
toutes les nationalités, restaurer l’unité historique des peuples et rallier
cette unité à la civilisation par la paix, élargir sans cesse le groupe
civilisé, donner le bon exemple aux peuples encore barbares, substituer les
arbitrages aux batailles ; enfin, et ceci résume tout, faire prononcer par
la justice le dernier mot que l’ancien monde faisait prononcer par la force. (Profonde
sensation.)
Messieurs, je le dis
en terminant, et que cette pensée nous encourage, ce n’est pas aujourd’hui que
le genre humain est en marche dans cette voie providentielle. Dans notre
vieille Europe, l’Angleterre a fait le premier pas, et par son exemple
séculaire elle a dit aux peuples : Vous êtes libres. La France a fait le
second pas, et elle a dit aux peuples : Vous êtes souverains. Maintenant
faisons le troisième pas et tous ensemble, France, Angleterre, Belgique,
Allemagne, Italie, Europe, Amérique, disons aux peuples : Vous êtes
frères ! (Immense acclamation. — L’orateur se rassied au milieu des
applaudissements.)
II
CLÔTURE DU CONGRÈS DE LA PAIX
24 août 1849.
Messieurs, vous m’avez permis de vous adresser quelques paroles de bienvenue ; permettez-moi de vous adresser quelques paroles d’adieu.
Je serai très court,
l’heure est avancée, j’ai présent à l’esprit l’article 3 du règlement, et,
soyez tranquilles, je ne m’exposerai pas à me faire rappeler à l’ordre par le
président. (On rit.)
Nous allons nous
séparer, mais nous resterons unis de cœur. (Oui ! oui !) Nous
avons désormais une pensée commune, messieurs ; et une commune pensée,
c’est, en quelque sorte, une commune patrie. (Sensation.) Oui, à dater
de ce jour, nous tous qui sommes ici, nous sommes compatriotes (Oui !
oui !)
Vous avez pendant
trois jours délibéré, discuté, approfondi, avec sagesse et dignité, de graves
questions, et à propos de ces questions, les plus hautes que puisse agiter
l’humanité, vous avez pratiqué noblement les grandes mœurs des peuples libres.
Vous avez donné aux
gouvernements des conseils, des conseils amis qu’ils entendront, n’en doutez
pas ! (Oui ! oui !) Des voix éloquentes se sont élevées
parmi vous, de généreux appels ont été faits à tous les sentiments magnanimes
de l’homme et du peuple ; vous avez déposé dans les esprits, en dépit des
préjugés et des inimitiés internationales, le germe impérissable de la paix
universelle.
Savez-vous ce que nous
voyons, savez-vous ce que nous avons sous les yeux depuis trois jours ?
C’est l’Angleterre serrant la main de la France, c’est l’Amérique serrant la
main de l’Europe, et quant à moi, je ne sache rien de plus grand et de plus
beau ! (Explosion d’applaudissements.)
Retournez maintenant
dans vos foyers, rentrez dans vos pays le cœur plein de joie, dites-y que vous
venez de chez vos compatriotes de France. (Mouvement. — Longue acclamation.)
Dites que vous y avez jeté les bases de la paix du monde, répandez partout
cette bonne nouvelle, et semez partout cette grande pensée.
Après les voix
considérables qui se sont fait entendre, je ne rentrerai pas dans ce qui vous a
été expliqué et démontré, mais permettez-moi de répéter, pour clore ce congrès
solennel, les paroles que je prononçais en l’inaugurant. Ayez bon espoir !
ayez bon courage ! L’immense progrès définitif qu’on dit que vous rêvez,
et que je dis que vous enfantez, se réalisera. (Bravo ! bravo !)
Songez à tous les pas qu’a déjà faits le genre humain ! Méditez le passé,
car le passé souvent éclaire l’avenir. Ouvrez l’histoire et puisez-y des forces
pour votre foi.
Oui, le passé et
l’histoire, voilà nos points d’appui. Tenez, ce matin, à l’ouverture de cette
séance, au moment où un respectable orateur chrétien tenait vos âmes
palpitantes sous la grande et pénétrante éloquence de l’homme cordial et du
prêtre fraternel, en ce moment-là, un membre de cette assemblée, dont j’ignore
le nom, lui a rappelé que le jour où nous sommes, le 24 août, est
l’anniversaire de la Saint-Barthélemy. Le prêtre catholique a détourné sa tête
vénérable et a repoussé ce lamentable souvenir. Eh bien ! ce souvenir, je
l’accepte, moi ! (Profonde et universelle impression.) Oui, je
l’accepte ! (Mouvement prolongé.)
Oui, cela est vrai, il
y a de cela deux cent soixante et dix-sept années, à pareil jour, Paris, ce
Paris où vous êtes, s’éveillait épouvanté au milieu de la nuit. Une cloche,
qu’on appelait la cloche d’argent, tintait au palais de justice, les
catholiques couraient aux armes, les protestants étaient surpris dans leur
sommeil, et un guet-apens, un massacre, un crime où étaient mêlées toutes les
haines, haines religieuses, haines civiles, haines politiques, un crime
abominable s’accomplissait. Eh bien! Aujourd’hui, dans ce même jour, dans cette
même ville, Dieu donne rendez-vous à toutes ces haines et leur ordonne de se
convertir en amour. (Tonnerre d’applaudissements.) Dieu retire à ce
funèbre anniversaire sa signification sinistre ; où il y avait une tache
de sang, il met un rayon de lumière (long mouvement) ; à la place
de l’idée de vengeance, de fanatisme et de guerre, il met l’idée de
réconciliation, de tolérance et de paix ; et, grâce à lui, par sa volonté,
grâce aux progrès qu’il amène et qu’il commande, précisément à cette date
fatale du 24 août, et pour ainsi dire presque à l’ombre de cette tour encore
debout qui a sonné la Saint-Barthélemy, non seulement anglais et français,
italiens et allemands, européens et américains, mais ceux qu’on nommait les
papistes et ceux qu’on nommait les huguenots se reconnaissent frères (mouvement
prolongé) et s’unissent dans un étroit et désormais indissoluble
embrassement. (Explosion de bravos et d’applaudissements. — M. l’abbé
Deguerry et M. le pasteur Coquerel s’embrassent devant le fauteuil du
président. — Les acclamations redoublent dans l’assemblée et dans les tribunes
publiques. — M. Victor Hugo reprend :)
Osez maintenant nier
le progrès ! (Nouveaux applaudissements.) Mais, sachez le bien,
celui qui nie le progrès est un impie, celui qui nie le progrès nie la
providence, car providence et progrès c’est la même chose, et le progrès n’est
qu’un des noms humains du Dieu éternel! (Profonde et
universelle sensation. — Bravo ! bravo !)
Frères, j’accepte ces
acclamations, et je les offre aux générations futures. (Applaudissements
répétés.) Oui, que ce jour soit un jour mémorable, qu’il marque la fin de
l’effusion du sang humain, qu’il marque la fin des massacres et des guerres,
qu’il inaugure le commencement de la concorde et de la paix du monde, et qu’on
dise : — Le 24 août 1572 s’efface et disparaît sous le 24 août 1849 !
(Longue et unanime acclamation. — L’émotion est à son comble ; les
bravos éclatent de toutes parts ; les anglais et les américains se lèvent
en agitant leurs mouchoirs et leurs chapeaux vers l’orateur, et, sur un signe
de M. Cobden, ils poussent sept hourras.)
Congrès de la Paix de 1869
Bruxelles, 4
septembre 1869.
Concitoyens des Etats-Unis d'Europe,
Permettez-moi de vous
donner ce nom, car la république européenne fédérale est fondée en droit, en
attendant qu'elle soit fondée en fait. Vous existez, donc elle existe. Vous
la constatez par votre union qui ébauche
l'unité. Vous êtes le commencement du grand avenir.
Vous me conférez la
présidence honoraire de votre congrès. J'en suis profondément touche.
Votre congrès est plus
qu'une assemblée d'intelligences; c'est une sorte de comité de rédaction des
futures tables de la loi. Une élite n'existe qu'à la condition de représenter
la foule; vous êtes cette élite-là. Dès à présent, vous signifiez à qui de
droit que la guerre est mauvaise, que le meurtre, même glorieux, fanfaron et
royal, est infâme, que le sang humain est précieux, que la vie est sacrée.
Solennelle mise en demeure.
Qu'une dernière guerre
soit nécessaire, hélas! Je ne suis, certes, pas de ceux qui le nient. Que sera
cette guerre ? Une guerre de
conquête. Quelle est la conquête à faire ? La liberté.
Le premier besoin de
l'homme, son premier droit, son premier devoir, c'est la liberté.
La civilisation tend
invinciblement à l'unité d'idiome, à l'unité de mètre, à l'unité de monnaie, et
à la fusion des nations dans l'humanité, qui est l'unité suprême. La concorde a
un synonyme, simplification; de même que la richesse et la vie ont un synonyme,
circulation. La première des servitudes, c'est
la frontière.
Qui dit frontière, dit
ligature. Coupez la ligature, effacez la frontière, ôtez le douanier, ôtez le
soldat, en d'autres termes, soyez libres; la paix suit.
Paix désormais profonde. Paix faite
une fois pour toutes. Paix inviolable. Etat normal du travail, de l'échange, de
l'offre et de la demande, de la production et de la consommation, du vaste
effort en commun, de l'attraction des industries, du va-et-vient des idées, du
flux et reflux humain.
Qui a intérêt aux
frontières? Les
rois. Diviser pour régner. Une frontière implique une guérite, une guérite
implique un soldat. « On ne passe pas », mot de tous les privilèges,
de toutes les prohibitions, de toutes les censures, de toutes les tyrannies. De
cette frontière, de cette guérite, de ce soldat, sort toute la calamité
humaine.
Le roi, étant
l'exception, a besoin, pour se défendre, du soldat, qui à son tour a besoin du
meurtre pour vivre. Il faut aux rois des armées, il faut aux armées la guerre.
Autrement, leur raison d'être s'évanouit. Chose étrange, l'homme consent à tuer
l'homme sans savoir pourquoi. L'art des despotes, c'est de dédoubler le peuple
en armée. Une moitié opprime l'autre.
Les guerres ont toutes
sortes de prétextes, mais n'ont jamais qu'une cause, l'armée. Ôtez l'armée,
vous ôtez la guerre. Mais comment supprimer l'armée ? Par la suppression
des despotismes.
Comme tout se tient ! Abolissez
les parasitismes sous toutes leurs formes, listes civiles, fainéantises payées,
clergés salariés, magistratures entretenues, sinécures aristocratiques,
concessions gratuites des édifices publics, armées permanentes; faites cette
rature, et vous dotez l'Europe de dix milliards par an. Voilà d'un trait de
plume le problème de la misère simplifié.
Cette simplification,
les trônes n'en veulent pas. De la les forêts de baïonnettes.
Les rois s'entendent
sur un seul point, éterniser la guerre. On croit qu'ils se querellent ; pas du
tout, ils s'entraident. Il faut, je le répète, que le soldat ait sa raison
d'être. Éterniser l'armée, c'est éterniser le despotisme; logique excellente,
soit, et féroce. Les rois épuisent leur malade, le peuple, par le sang versé.
Il y a une farouche fraternité des glaives d'ou résulte l'asservissement des
hommes.
Donc, allons au but,
que j'ai appelé quelque part « la résorption du soldat dans le
citoyen ». Le jour où cette reprise de possession aura eu lieu, le jour où
le peuple n'aura plus hors lui l'homme de guerre, ce frère ennemi, le peuple se
retrouvera un, entier, aimant, et la civilisation se nommera harmonie, et aura
en elle, pour créer, d'un côté la richesse et de l'autre la lumière, cette
force, le travail, et cette âme, la paix.
Des
affaires de famille retenaient Victor
Hugo a Bruxelles. Cependant, sur la vive insistance du Congrès, il se
décida à aller à Lausanne. Le 14 septembre, il ouvrit le Congrès. Voici ses paroles :
Les mots me manquent
pour dire à quel point je suis touché de l'accueil qui m'est fait. J'offre au
congrès, j'offre a ce généreux et sympathique auditoire, mon émotion profonde.
Citoyens, vous avez eu raison de choisir pour lieu de réunion de vos
délibérations ce noble pays des Alpes. D'abord, il est libre ; ensuite, il
est sublime. Oui, c'est ici, oui, c'est en présence de cette nature
magnifique qu'il sied de faire les grandes déclarations d'humanité, entre
autres celles-ci: Plus de guerre !
Une question domine ce
congrès.
Permettez-moi, puisque
vous m'avez fait l'honneur insigne de me choisir pour président, permettez-moi
de la signaler. Je le ferai en peu de mots. Nous tous qui sommes ici, qu'est-ce
que nous voulons ? La paix. Nous voulons la paix, nous la voulons
ardemment. Nous la voulons absolument. Nous la voulons entre
l'homme et l'homme, entre le peuple et le peuple, entre la race et la race,
entre le frère et le frère, entre Abel et Caïn. Nous voulons
l'immense apaisement des haines.
Mais cette paix,
comment la voulons-nous ? La voulons-nous à tout prix ? La voulons-nous sans
conditions ? Non ! Nous ne voulons pas de la paix le dos courbé et le front
baissé ; nous ne voulons pas de la paix sous le despotisme; nous ne voulons pas
de la paix sous le bâton ; nous ne voulons pas de la paix sous le sceptre !
La première condition
de la paix, c'est la délivrance: Pour cette délivrance, il faudra, à coup sur,
une révolution, qui sera la suprême, et peut-être, hélas ! Une guerre, qui sera
la dernière. Alors
tout sera accompli. La paix, étant inviolable, sera éternelle. Alors, plus
d'armées, plus de rois. Evanouissement du passe. Voilà ce que nous voulons.
Nous voulons que le
peuple vive, laboure, achète, vende, travaille, parle, aime et pense librement,
et qu'il y ait des écoles faisant des citoyens, et qu'il n'y ait plus de
princes faisant des mitrailleuses. Nous voulons la grande république
continentale, nous voulons les Etats-Unis d'Europe, et je termine par ce mot:
La liberté, c'est le But ; la paix, c'est le résultat.
Les délibérations des Amis de la paix durèrent quatre jours. Victor Hugo
fit en ces termes la clôture du Congrès:
Citoyens,
Mon devoir est de clore ce congrès par une parole finale.
Je tâcherai qu'elle soit cordiale. Aidez-moi.
Vous êtes le congrès
de la paix, c'est-a-dire de la conciliation. A ce sujet,
permettez-moi un souvenir.
Il y a vingt ans, en
1849, il y avait à Paris ce qu'il y a aujourd'hui à Lausanne, un congrès de la
paix. C'était le 24 août, date sanglante, anniversaire de la Saint Barthelemy.
Deux prêtres, représentant les deux formes du christianisme, étaient la; le pasteur
Coquerel et l'abbé Deguerry. Le président du congrès, celui qui a l'honneur de
vous parler en ce moment, évoqua le souvenir néfaste de 1572, et, s'adressant
aux deux prêtres, leur dit: "Embrassez-vous!"
En présence de cette
date sinistre, aux acclamations de l'assemblée,
le catholicisme et le
protestantisme s'embrassèrent.
Aujourd'hui quelques
jours a peine nous séparent d'une autre date, aussi illustre que la première
est infâme, nous touchons au 21 septembre. Ce jour-là, la république française
a été fondée, et, de même que le 24 août 1572 le despotisme et le fanatisme
avaient dit leur dernier mot : « Extermination », le 21 septembre
1792 la démocratie a jeté son premier cri: « Liberté, égalité, fraternité
! »
Eh bien! en présence
de cette date sublime, je me rappelle ces deux religions représentées par deux
prêtres, qui se sont embrassées, et je demande un autre embrassement. Celui-là
est facile et n'a rien à faire oublier. Je demande l'embrassement de la
république et du socialisme.
Nos ennemis disent: le
socialisme, au besoin, accepterait l'empire. Cela n'est pas. Nos ennemis disent : la république ignore le socialisme. Cela n'est
pas.
La haute formule
définitive que je rappelais tout a l'heure, en même temps qu'elle exprime toute
la république, exprime aussi tout le socialisme.
A côté de la liberté,
qui implique la propriété, il y a l'égalité, qui implique le droit au travail,
formule superbe de 1848 ! Et il y a la fraternité, qui implique la solidarité.
Donc, république et
socialisme, c'est un.
Moi qui vous parle,
citoyens, je ne suis pas ce qu'on appelait autrefois un républicain de la
veille, mais je suis un socialiste de l'avant-veille. Mon socialisme date
de 1828. J'ai donc le droit d'en parler.
Le socialisme est
vaste et non étroit. Il s'adresse à tout le problème humain. Il embrasse la
conception sociale tout entière. En même temps qu'il pose l'importante question
du travail et du salaire, il proclame l'inviolabilité de la vie humaine,
l'abolition du meurtre sous toutes ses formes, la résorption de la pénalité par
l'éducation, merveilleux problème résolu. Il proclame l'enseignement gratuit et
obligatoire. Il proclame le droit de la femme, cette égale de l'homme. Il
proclame le droit de l'enfant, cette responsabilité de l'homme. Il proclame
enfin la souveraineté de l'individu, qui est identique à la liberté.
Qu'est-ce que tout
cela ? C'est
le socialisme. Oui. C'est aussi la République !
Citoyens, le
socialisme affirme la vie, la république affirme le droit. L'un élève
l'individu a la dignité d'homme, l'autre élève l'homme a la dignité de citoyen.
Est-il
un plus profond accord?
Oui, nous sommes tous
d'accord, nous ne voulons pas de césar, et je défends le socialisme calomnie !
Le jour où la question
se poserait entre l'esclavage avec le bien-être, _panem et circenses_, d'un
coté, et, de l'autre, la liberté avec la pauvreté, pas un, ni dans les rangs
républicains, ni dans les rangs socialistes, pas un n'hésiterait ! Et tous, je
le déclare, je l'affirme, j'en réponds, tous préfèreraient au pain blanc de la
servitude le pain noir de la liberté.
Donc, ne laissons pas poindre et
germer l'antagonisme. Serrons-nous donc, mes frères socialistes, mes frères
républicains, serrons-nous étroitement autour de la justice et de la vérité, et
faisons front à l'ennemi.
Qu'est l'ennemi?
L'ennemi, c'est
plus et moins qu'un homme. C'est un ensemble de faits hideux
qui pèse sur le monde et qui le dévore. C'est un monstre aux mille griffes,
quoique cela n'ait qu'une tête. L'ennemi, c'est cette incarnation sinistre du
vieux crime militaire et monarchique, qui nous bâillonne et nous spolie, qui
met la main sur nos bouches et dans nos poches, qui a les millions, qui a les
budgets, les juges, les prêtres, les valets, les palais, les listes civiles,
toutes les armées, et pas un seul peuple. L'ennemi, c'est ce qui règne,
gouverne, et agonise en ce moment.
Citoyens, soyons les
ennemis de l'ennemi, et soyons nos amis ! Soyons une seule âme pour le
combattre et un seul cœur pour nous aimer. Ah ! Citoyens : Fraternité !
Encore un mot et j'ai
fini.
Tournons-nous vers
l'avenir. Songeons au jour certain, au jour inévitable, au jour prochain
peut-être, ou toute l'Europe sera constituée comme ce noble peuple suisse qui
nous accueille a cette heure. Il a ses grandeurs, ce petit peuple ; il a une
patrie qui s'appelle la République, et il a une montagne qui s'appelle la
Vierge.
Ayons comme lui la
République pour citadelle, et que notre liberté, immaculée et inviolée, soit,
comme la Jungfrau, une cime vierge en pleine lumière.
Je salue la révolution future.
« Pour la guerre dans le présent et pour la paix dans
l'avenir »
Extraits
La situation de Hugo, politique et
personnelle, est complexe. Ce discours est celui d'un élu de Paris, certes.
Mais aussi Hugo arrive de la ville, où il a vécu l'expérience du siège et les
situations difficiles que celui-ci a engendrées. D'autre part, c'est le poète
illustre, auréolé de ses œuvres, de son combat contre l'Empire, et de son exil.
Enfin, c'est le discours d'un exilé justement, rentré dans un pays transformé
par vingt années d'expansion économique puis bouleversé, qu'il ne connaît plus
vraiment, et à la faveur d'une défaite.
À cette assemblée,
Hugo va dire ce qu'elle ne veut ni ne peut entendre, ni politiquement, ni
intellectuellement, ni culturellement.
Il va faire, mais à la
tribune d'une assemblée, ce qu'il fait dans ses épopées, et dans ses romans
comme les Misérables et bientôt Quatrevingt-treize : proposer une dialectique
visionnaire et quasiment impossible. Il faut lire Quatrevingt-treize à travers
ce texte qui le précéda, et ce texte lui-même dans sa situation et dans son
mouvement.
D'abord,
à ces provinciaux, un éloge de Paris, qu'il représente comme élu :
Paris a fait face à toute l'Allemagne ; une ville a tenu
en échec une invasion ; dix peuples coalisés, ce flot des hommes du Nord qui,
plusieurs fois déjà, a submergé la civilisation, Paris a combattu cela. Trois cent mille pères de famille se sont
improvisés soldats. Ce grand peuple parisien a créé des bataillons, fondu des
canons, élevé des barricades, creusé des mines, multiplié ses forteresses,
gardé son rempart ; et il a eu faim, et il a eu froid ; en même temps que tous
les courages, il a eu toutes les souffrances. Les énumérer n'est pas inutile,
l'histoire écoute.
Puis,
prolongeant et amplifiant cet éloge, le mandat donné à ses députés :
[…]
cette cité auguste, Paris, nous a donné un mandat qui accroît son péril et qui
ajoute à sa gloire, c'est de voter contre le démembrement de la patrie. […] Et,
chose digne de remarque, c'est pour l'Europe en même temps que pour la France
que Paris nous a donné le mandat d'élever la voix. Paris fait sa fonction de
capitale du continent.
Puis une provocation, faisant référence au concile du
Vatican :
[…] Car, dans cette fatale année de concile et de carnage… (Oh ! oh !) Voix à gauche : Oui ! oui !
très-bien !
M. Victor Hugo. —
Je ne croyais pas qu'on pût nier l'effort du pontificat pour se déclarer
infaillible, et je ne crois pas qu'on puisse contester le fait, qu'à côté du
pape gothique, qui essaye de revivre, l'empereur gothique reparaît. (Bruit à
droite. — Approbation sur les bancs de la gauche.)
Puis
les attaques contre la Prusse, soigneusement distinguée de l'Allemagne nouvelle
:
Je sais bien qu'on
nous dit : Subissez les conséquences de la situation faite par vous. On nous dit encore :
Résignez-vous, la Prusse vous prend l'Alsace et une partie de la Lorraine, mais
c'est votre faute et c'est son droit ; pourquoi l'avez-vous attaquée, elle ne
vous faisait rien ; la France est coupable de cette guerre et la Prusse en est
innocente. La Prusse innocente !… Voilà plus d'un siècle que nous assistons aux
actes de la Prusse, de cette Prusse qui n'est pas coupable, dit-on,
aujourd'hui. Elle a pris… (Bruit dans
quelques parties de la salle.) [Diverses interruptions] […] Se figure-t-on quelque chose de pareil
à ceci : la suppression de l'avenir par le passé ? Eh bien, la suppression de la France par la
Prusse, c'est le même rêve.
Puis
les explications de vote :
Je ne voterai point
cette paix, parce que, avant tout, il faut sauver l'honneur de son pays ; je ne
la voterai point, parce qu'une paix infâme est une paix terrible. Et pourtant,
peut-être aurait-elle un mérite à mes yeux : c'est qu'une telle paix, ce n'est
plus la guerre, soit, mais c'est la haine. (Mouvement.) La haine contre qui ?
Contre les peuples ? non ! contre les rois ! Que les rois recueillent ce qu'ils
ont semé. […] Vous créez la haine profonde ; vous indignez la conscience
universelle. […] Tout ce que la France perdra, la Révolution le gagnera.
(Approbation sur les bancs de la gauche.)
Puis
la vision de l'avenir :
Oh ! une heure
sonnera — nous la sentons venir — cette revanche prodigieuse. Nous entendons
dès à présent notre triomphant avenir marcher à grands pas dans l'histoire. Oui, dès demain, cela va commencer
; dès demain, la France n'aura plus qu'une pensée : se recueillir, se reposer
dans la rêverie redoutable du désespoir, reprendre des forces ; élever ses
enfants, nourrir de saintes colères ces petits qui deviendront grands ; forger
des canons et former des citoyens, créer une armée qui soit un peuple ; appeler
la science au secours de la guerre ; étudier le procédé prussien comme Rome a
étudié le procédé punique ; se fortifier, s'affermir, se régénérer, redevenir la
grande France, la France de 92, la France de l'idée et la France de l'épée. (Très-bien
! Très-bien !)
Puis tout à coup,
un jour, elle se dressera ! Oh ! elle sera formidable ; on la verra, d'un bond,
ressaisir la Lorraine, ressaisir l'Alsace !
Est-ce tout ? non !
non ! saisir — écoutez-moi, — saisir Trèves, Mayence, Cologne, Coblentz…
Sur divers bancs. — Non ! non ! [Diverses
interruptions.]
M.
Victor Hugo. — […] Et on entendra la
France crier : C'est mon tour ! Allemagne, me voilà ! Suis-je ton ennemie ? Non
! je suis ta sœur. (Très-bien ! Très-bien !) Je t'ai tout repris, et je te
rends tout, à une condition : c'est que nous ne ferons plus qu'un seul peuple,
qu'une seule famille, qu'une seule république. (Mouvements divers.) Je vais démolir mes forteresses, tu vas
démolir les tiennes. Ma vengeance, c'est la fraternité ! (À gauche : Bravo
! bravo !) Plus de frontières ! Le Rhin à
tous. Soyons la même République, soyons les États-Unis d'Europe, soyons la
fédération continentale, soyons la liberté européenne, soyons la paix
universelle ! Et maintenant serrons-nous la main, car nous nous sommes rendu
service l'une à l'autre : tu m'as délivrée de mon empereur, et je te délivre du
tien. (Bravo ! bravo
! Applaudissements.)
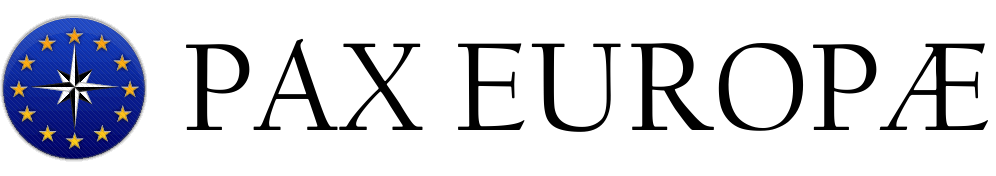
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire